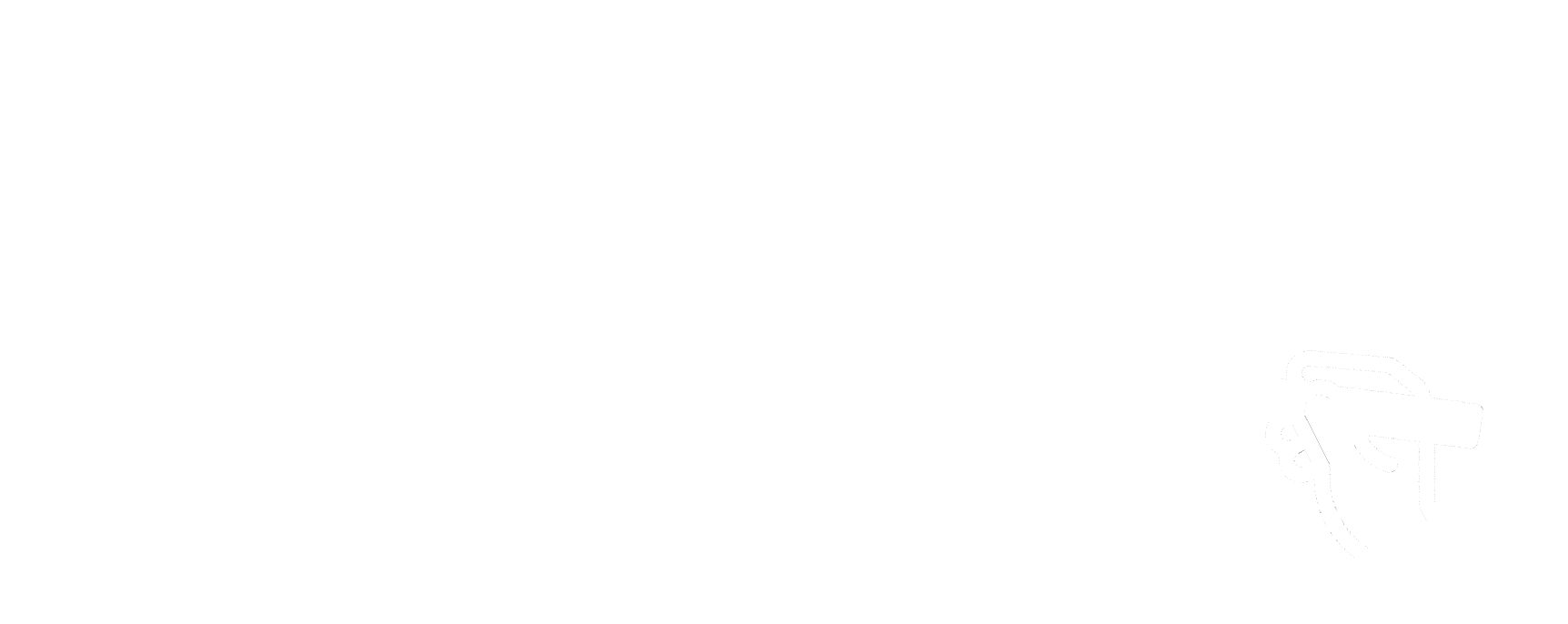Résumé
Le cours Limits to digitalization est un cours électif de 24h ouvert à l’ensemble des étudiantes et étudiants de l’École d’Affaires Publiques en M1 et en format de 12h ouvert à l’ensemble des étudiantes et étudiants de l’École Urbaine. Le cours aborde autant le fonctionnement des infrastructures numériques que les effets environnementaux directs et indirects de la numérisation. Il vise à fournir un cadre analytique aux étudiants pour déterminer le potentiel réel de la numérisation vis-à-vis des objectifs de transition écologique.
1 Introduction
1.1 Objectifs
Tout d’abord, un aperçu général de la matérialité des infrastructures numériques est présenté, à la fois par le biais d’observations sur le terrain et d’apports théoriques en classe. L’objectif est de fournir une base solide de ce qui est nécessaire pour fabriquer, déployer, utiliser et éliminer les systèmes numériques. Deuxièmement, l’évaluation des impacts environnementaux du secteur numérique est abordée à plusieurs échelles (effets directs et indirects, évaluations nationales, mondiales, par service). Il s’agit de donner aux étudiantes et étudiants une culture qui les aidera à naviguer dans des discours complexes et, en fin de compte, à améliorer la prise de décision. Troisièmement, ce cours se penche sur les futurs possibles des TIC dans un monde durable. Des études de cas réels portant sur le déploiement d’infrastructures en Europe et aux États-Unis, le développement industriel en Asie et l’évaluation du territoire français sont étudiées. Cette dernière partie vise à fournir aux étudiants des capacités stratégiques et de planification concernant la numérisation des activités humaines, ou éventuellement leur non-numérisation, dans un monde de plus en plus contraint.
1.2 Historique
Ce cours a été donné deux fois pendant l’année universitaire 2021-2022 et 2023-2024 dans deux Masters différents à Sciences Po Paris. Un format de 24 heures, avec douze sessions de 2 heures, à l’École des Affaires Publiques (EAP), et un format plus court de 12 heures à l’École Urbaine (EU).
2 Insertion du cours dans les parcours
Niveau : M1
Langue : Anglais
Obligatoire, optionnel : Optionnelle
Nom dans la maquette : The futures of digital systems within the environmental crisis
Crédits ECTS : 3
Nombre d’étudiantes et étudiants : 21 en EAP, 14 en EU en 2022-2023 et 23 en EAP, 13 en EU en 2022-2023.
Nombre d’enseignantes et enseignants impliqués : 1
Contexte pédagogique : 18 heures de cours magistraux, 4 heures de séances de TP et 2 heures d’évaluation finale.
3 Plan du cours
Les cours ont lieu à Sciences Po Paris soit en douze sessions de deux heures de septembre à novembre à l’École des Affaires Publiques, soit en trois sessions allégées de quatre heures durant la même période à l’École Urbaine. Il s’agit de cours électifs donc les étudiants choisissent généralement eux-mêmes de participer à cet enseignement et disposent d’une sensibilité aux questions environnementales et/ou numériques sans pour autant disposer de connaissances particulières sur ces sujets. À cet égard, aucune connaissance préalable est demandée et ce cours est conçu en conséquence. Dernière particularité, les cours sont données à des étudiants majoritairement anglophones venant en général de 10 à 12 pays différents.
Les douze points présentés ci-dessous correspondent à une configuration de douze sessions de deux heures.
1 Croiser les perspectives (crossing perspectives)La tension fondamentale entre la crise environnementale et la numérisation est au cœur de ce cours. Alors que la communauté scientifique commence à mieux comprendre l’empreinte environnementale de la numérisation, il est très difficile de savoir si la numérisation, dans son ensemble, a un impact positif sur la transition écologique et dans quelles conditions elle peut être favorisée. Cette première session s’appuie sur le concept d’imaginaires sociotechniques défini en études des sciences et des techniques (science and technology studies) pour montrer comment les visions de futurs soutenables et numérisés s’entrechoquent.
2 Comprendre les infrastructures numériques (understanding digital infrastructures)Le transfert, le calcul et l’utilisation des données numériques nécessitent une série d’infrastructures interconnectées. Trois types de systèmes sont généralement distingués dans les sciences de l’environnement appliquées à la numérisation : les centres de données, les réseaux de télécommunications et les équipements des utilisateurs. La compréhension du fonctionnement de ces infrastructures et de leur matérialité est un préalable à l’analyse environnementale.
3 Déployer les infrastructures numériques (deploying digital infrastructures)Comprendre le fonctionnement général des infrastructures numériques est une chose, mais elles n’apparaissent pas du jour au lendemain. Avant d’installer un centre de données, des réseaux de télécommunication ou des usines de composants électroniques, il faut négocier les conditions physiques, politiques, environnementales et économiques. Tout comme la maintenance, cette phase révèle en partie ce que coûte réellement le développement de ces infrastructures. Ce déploiement n’est donc pas anodin et doit être compris tant par les décideurs politiques que par les citoyens qui vivront avec ces infrastructures.
4 Les conditions matérielles du secteur numérique (the material conditions of ICT)Pour produire la quantité phénoménale de composants, équipements et matériels numériques utilisés aujourd’hui, il est nécessaire d’assurer un flux constant et mondialisé de matériaux. Ces flux relient les zones minières aux usines de fabrication, et ces usines aux installations de recyclage et de traitement des déchets, mais peuvent-ils être maintenus ? Quelles sont les exigences matérielles du secteur numérique et comment se situent-elles par rapport à la demande générale ? En outre, quel est le coût social et environnemental de l’extraction de ces ressources ?
5 L’empreinte environnementale du secteur numérique (the environmental footprint of the digital sector)Pour les besoins de l’analyse environnementale du secteur numérique, il est d’usage de le diviser en trois parties techniques : les centres de données, les réseaux et les équipements des utilisateurs. S’y ajoute un périmètre de services : à quelques exceptions près, tout service numérique a besoin de centres de données, de réseaux de télécommunication et d’équipements informatiques pour fonctionner. Séparément, nous examinons d’autres secteurs (transport, énergie, industrie, etc.) pour estimer les effets indirects de la numérisation (effet de rebond, substitution, etc. conduisant à des impacts évités ou ajoutés) sans vraiment imposer une méthode officielle. Cette session ne s’intéressera qu’à l’empreinte environnementale du secteur numérique.
6 Les risques climatiques de la numérisation (the climate risks on ICT)À mesure que nous nous enfonçons dans la crise environnementale, ce qui était autrefois un risque devient de nouvelles conditions de vie. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, la biodiversité continue de décliner, nous dépassons les nouvelles limites planétaires et les événements climatiques deviennent plus intenses. Il ne s’agit pas vraiment de parler de risques, ce qui impliquerait que l’on puisse les éviter, mais de vulnérabilité, car ces risques sont devenus réels et ne peuvent plus être évités. Au mieux, nous pouvons les atténuer tout en modifiant radicalement nos modes de vie et nos systèmes de production.
7 Projet collectif 1/3 Les étudiants forment des groupes de 4 personnes auxquelles sont assignées une ville et une solution numérique par l’enseignant. Chaque groupe joue le rôle de fonctionnaires et a pour but d’émettre une recommandation sur la validité de la solution numérique afin d’aider à atteindre les objectifs de transition de la ville. Par exemple, est-ce que le développement de plateformes de VTC permet d’aider à atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone des transports à Dublin ? Les étudiantes et étudiants doivent mobiliser tous les outils théoriques et pratiques pour répondre à ce type de questions.La première session du projet collectif vise à prendre connaissance de la ville assignée. Chaque groupe doit produire une synthèse de l’évolution environnementale et climatique de la ville d’aujourd’hui jusqu’à 2050 et des objectifs de transition de cette dernière.Voir la section 5.1 pour plus de détails
8 Étude de cas : l’empreinte environnementale de la fabrication de semiconducteurs à Taïwan (case study: manufacturing electronics in Taiwan).Cette session s’appuie principalement sur l’article de recherche de Gauthieret al.(2024).
9 Modéliser les effets environnementaux indirects de la numérisation (modelling indirect effects of digitalisation).Les systèmes numériques ont profondément modifié les activités des sociétés postindustrielles. Pourtant, il est difficile d’évaluer si ces changements ont été bénéfiques au regard des engagements climatiques et des limites planétaires. L’estimation de ces effets sur les systèmes, les activités et les modes de vie est au cœur de nombreux débats sur l’empreinte environnementale globale de la numérisation. Les effets positifs l’emportent-ils sur les effets négatifs, et si oui, comment et dans quelles conditions ?
10 Projet collectif 2/3
La deuxième session du projet collectif vise à faire l’arbre de conséquences de leur solution numérique en s’appuyant sur les supports théoriques fournis lors de la session précédente. Ici, les étudiants doivent cartographier tous les effets environnementaux indirects potentiels de leur solution numérique dans la ville assignée Voir la section 5.1 pour plus de détails.
11 Analyse des risques et pensée critique (risk assessment and critical thinking)Si nous avons vu plus haut les risques et vulnérabilités climatiques auxquels est confronté le secteur numérique, d’autres enjeux et risques stratégiques sont à prendre en compte. Les défis environnementaux de la numérisation ne peuvent être pris isolément car ils affectent toutes les activités humaines (approvisionnement en matériaux, droit international et souverain, sécurité, etc.) Ainsi, une stratégie environnementale pertinente pour la numérisation doit également définir comment elle interagit avec les stratégies nationales et internationales
12 Project collectif 3/3
La dernière session est dédiée à la présentation des résultats. Chaque groupe dispose de dix à quinze minutes pour présenter leur recherche et leur recommandation. Un échange de cinq minutes est prévu après chaque présentation.Voir la section 5.1 pour plus de détails.
4 Pédagogie
Ce cours est basé sur un apport théorique supporté par des nombreuses ressources interactives (cartes, vidéos, images). La compréhension des infrastructures numériques fait l’objet d’un exercice pratique de 1 heure où les étudiants, par groupes de 3 ou 4, ont une heure pour trouver quatre éléments typiques des réseaux de télécommunication en milieu urbain : une station 4G, des marquages de génie civil au sol, un point de mutualisation de zone pour la fibre, des chambres télécom. Parfois, le format varie vers une visite guidée avec l’enseignant. Cet exercice s’appuie sur les travaux d’Ingrid Burrington et les documents sont disponibles dans la page de la Session 3 des ressources en ligne. L’évaluation finale passe par un projet collectif qui invite à un croisement multidisciplinaire pour évaluer une technologie dans un contexte urbain déterminé. L’ensemble du cours tend vers un maximum d’interactivité avec la classe tout en apportant des connaissances théoriques suffisamment solides pour le projet collectif.
Figure 1. Visite guidée avec l’enseignant qui soulève la plaque d’une chambre de tirage avec une marque de génie civil inscrit sur le trottoir. Crédit : Merel van Zanen.
5 Évaluation finale
Premièrement, ce cours est évalué sur un projet collectif (70 %). Sur la base des connaissances théoriques et pratiques dispensées pendant le cours, les étudiants font une évaluation des effets environnementaux d’une technologie donnée dans un périmètre restreint (ville), et son adéquation avec les politiques de transition. Deuxièmement, un court essai individuel (2 pages maximum) est également noté (20 %). Enfin, la participation et l’engagement comptent pour 10 % de la note finale.
5.1 Projet collectif
Les étudiants sont répartis en groupe de 4 et une grande ville et un service/technolique numérique est assigné par l’enseignant à chaque groupe (par exemple, les voitures autonomes à Melbourne, les services de partage d’habitation (Airbnb ou autres) à Barcelone, le télétravail à Munich,...).
Ils prennent le rôle de fonctionnaires à qui l’on demande de formuler une recommandation à l’intention du cabinet du maire. L’analyse doit aider la ville à refuser, transformer ou accepter le déploiement d’une technologie donnée. La première étape de l’analyse consiste à évaluer l’évolution du climat et de l’environnement, les risques associés présents et futurs dans la ville (présents et futurs) et à résumer les politiques de transition existantes. Durant la deuxième étape de l’analyse, les élèves doivent analyser les effets environnementaux indirects d’une technologie numérique donnée dans leur ville en réalisant un arbre des conséquences. Chaque groupe présente son analyse finale et sa recommandation en 20 minutes et fournit un résumé écrit d’une page de sa recommandation ainsi que les documents qu’il a produits en cours de route.
Figure 2. Arbre de conséquences réalisé par un groupe d’étudiants travaillant sur le développement de plateformes VTC à Melbourne.
L’arbre de conséquences ci-dessus a été réalisé par trois étudiantes et étudiants de l’École Urbaine en 2 heures. Il était demandé d’étudier les effets environnementaux liés au déploiement des solutions de plateformes VTC (Uber, Lyft) à Melbourne. Les étudiant·e·s ont identifiés les effets dits de second ordre (efficacité/optmisation, subsitution, effets rebond directs) et de plus grand ordre (effets rebond indirects, effets macro-économiques) en bleu, les conséquences de ces effets à Melbourne en jaune et des informations contextuelles (en contour arrondi), ainsi que les politiques publiques qui permettraient de contenir les effets négatifs et de favoriser les effets positifs. Dans le contexte actuel de Melbourne, les étudiantes et étudiants estiment que le déploiement des solutions de ride-sharing augmentent les émissions de transport plutôt que les réduire en s’appuyant sur les travaux de Coulombelet al.(2019) (encart en haut à droite de la figure 2).
5.2 Essai individuel
À la fin de l’enseignement, il est demandé aux étudiantes et étudiants de rédiger un essai de deux pages maximum où ils doivent répondre aux deux questions suivantes :
- Qu’est-ce que j’ai appris qui m’a particulièrement frappé ? (What did I learn?)
- Quels sont les enseignements que j’en tire pour mon avenir ? (What will I take away with me?)
L’objectif de cet essai individuel est de fournir à l’enseignant un point de référence sur ce qui a le plus retenu l’attention des étudiants et d’observer, le cas échéant, les changements de posture entre le début et la fin de l’enseignement.
6 Évaluation du cours par les étudiants
Le cours et ses apports a pu être évalué de deux façons chaque année : de façon quantitative, via l’évaluation des enseignements par les étudiants qui est obligatoire à Sciences Po, et de façon qualitative, via l’essai individuel de deux pages écrit par les étudiants après la fin du cours.
6.1 Analyse quantitative
À la fin des enseignements, les étudiantes et étudiants donnent leur degré de satisfaction général. Les résultats pour l’EAP et l’EU sont présentés dans le tableau ci-après.
| Évaluations EAP 2022-2023 (21 étudiantes et étudiants) | Excellent | Bon | Moyen | Insuffisant | Non pertinent |
| Quel degré de satisfaction accorderiez-vous à l’expérience d’apprentissage proposée dans ce cours ? | 71 % | 19 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Évaluations EU 2022-2023 (14 étudiants) | Excellent | Bon | Moyen | Insuffisant | Non pertinent |
| Quel degré de satisfaction accorderiez-vous à l’expérience d’apprentissage proposée dans ce cours ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En général, les étudiantes et étudiants ont été réceptifs à l’enseignement. Les résultats du questionnaire de l’École Urbaine peuvent être expliqués par une classe plus petite avec laquelle il a été facile d’interagir malgré les heures limitées. Les évaluations pour l’année 2023-2024 ne sont pas disponibles il s’agit donc des seules données quantitatives disponibles aujourd’hui.
6.2 Analyse qualitative
L’analyse qualitative est basée sur les commentaires laissés par les étudiants dans leur évaluation de l’enseignement menée par Sciences Po, et par les essais individuels rédigés par les étudiants à la fin de l’enseignement.
Plusieurs thèmes se dégagent. En premier lieu, les étudiants mettent en avant le mélange entre théorie et pratique durant tout le long de l’enseignement :
- « Perspective appliquée et critique. Beaucoup d’informations détaillées et intéressantes, des explications claires, un sens de la matérialité, un équilibre entre la théorie et la pratique. »
- « Le cours fait le lien entre la théorie et l’empirisme de manière intuitive et efficace. »
- « Cet atelier présente un équilibre étonnant entre la théorie et la pratique, la connaissance et l’application. »
Les ressources pédagogiques et les éléments visuels qui les accompagnent sont aussi plébiscités par les étudiants :
- « Contenu suivant une logique, très accessible, notamment par la partie visualisation. »
- « Ressources pédagogiques particulièrement claires et complètes. »
- « Contenu pédagogique très enrichissant, explications approfondies et réponses appuyées aux questions des étudiants. »
- « Le format pédagogique et le contenu du cours en lui-même étaient excellents, et les ressources fournies très utiles. »
De nombreux étudiants étaient peu familiers avec le sujet et n’avaient pas de connaissances techniques. Ils ont toutefois réussi à gagner en confiance au fur et à mesure du cours :
« J’ai beaucoup appris sur des sujets que je ne maitrisais pas du tout et que vous avez rendu accessible. »
- « Je craignais de ne pas pouvoir suivre le cours en raison de mon manque de compréhension technologique. Il s’est avéré que ce n’était pas du tout le cas, ce qui est également étroitement lié à ce que j’ai retiré du cours, à savoir une compréhension (très basique) des technologies qui sont cruciales pour la transformation numérique urbaine et des infrastructures matérielles qui les rendent possibles. »
- « Pour commencer, comme indiqué au début du cours, j’ai fait part de mes réticences vis-à-vis de la numérisation. Malgré ces réserves, j’ai beaucoup apprécié ce cours, car il était très perspicace et critique. »
L’objectif pédagogique principal de ce cours est la transmission des capacités d’analyse critique vis-à-vis des discours mêlant numérisation et soutenabilité. Dans une majorité des essais individuels, de nombreux étudiants témoignent d’un sens critique plus fort, voire d’un changement de perspective par rapport à leurs opinions antérieures sur les technologies numériques :
- « Je l’admets, j’ai cru aveuglément aux promesses faites par les technologies intelligentes de réduire les émissions de carbone et les déchets. Bien que de nombreuses technologies numériques soient susceptibles de réduire les émissions en sensibilisant à l’utilisation de l’énergie (par exemple, les compteurs intelligents) ou en augmentant l’efficacité, leur efficacité dépendra en grande partie de la transition énergétique vers l’abandon des combustibles fossiles. »
- « L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises est que même si la plupart des futurs numériques imaginés sont irréalistes, il est important de travailler à les contredire, en démontrant avec des données et une bonne argumentation les dommages qu’ils peuvent causer. »
- « J’étais déjà convaincue que le secteur numérique et la numérisation ne nous sauveraient pas tous, mais il était intéressant de pouvoir étayer cette affirmation par des preuves encore plus concrètes, tout en encourageant l’esprit critique. »
- « L’aspect le plus important que je retiens de ce cours est que je me distancie de ma compréhension antérieure de la numérisation comme une simple philosophie par laquelle nous nous organisons. »
- « J’avais une impression limitée du secteur technologique et de ses répercussions. Je pensais que le secteur numérique n’avait pas de défauts ni de points de controverse. Cependant, après 12 sessions de cours, je peux avouer que ma vision de la digitalisation a changé radicalement. Pas dans le mauvais sens du terme, bien au contraire, aujourd’hui je vois le secteur dans une perspective plus critique, objective et analytique. »
- « Ce cours a changé ma vision personnelle du monde numérique et les connaissances que j’ai acquises me serviront pour toutes les considérations et décisions que je pourrais avoir à prendre dans ma future carrière. »
- « Je retiens surtout de ce cours une meilleure remise en question des efforts et des stratégies de numérisation (et de leur nécessité). »
- « Ce séminaire a favorisé ma vision agnostique de la technologie et a élargi ma position critique grâce à une série d’arguments nouveaux et critiques. Il a déjà eu un impact sur mes futurs choix de carrière ainsi que sur mon évaluation stratégique du sujet de la numérisation. »
Au-delà des commentaires sur l’organisation (tous les cours de cet enseignement commencaient à 8h du matin), les principaux retours négatifs concernent l’évaluation finale pour l’EAP (la première année, le projet collectif était fait en 2 heures), et le manque d’heures d’enseignement pour l’EU (12 heures au lieu de 24 heures) :
- « La seule chose que je changerais dans ce cours est de diviser l’atelier d’évaluation finale en plusieurs sessions pour permettre aux étudiants d’approfondir le sujet. »
- « Plus de temps pour l’analyse finale ! L’objectif était d’être le plus proche possible de la réalité, mais en réalité, une telle analyse ne se fait pas en deux heures. »
- « Une seule évaluation à la fin du semestre dans des conditions assez stressantes, sans vraiment avoir le temps de comprendre les attentes du travail de recherche en groupe en deux heures. »
- « Plus de séances/temps de cours pour aller au bout des choses. »
- « Nous aurions souhaité que cet atelier soit transformé en une véritable classe de 24 heures. »
Ressources
Les ressources sont accessibles en ligne :https://gauthierroussilhe.com/book/sciencespo/.
Références
Coulombel, Nicolas, Boutueil, Virginie, Liu, Liu, Viguie, Vincent, Yin, Biao (2019). Substantial rebound effects in urban ridesharing: Simulating travel decisions in Paris, France. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 71, 110-126. https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.12.006
Roussilhe, Gauthier, Pirson, Thibault, Xhonneux, Mathieu, Bol, David (2024). From silicon shield to carbon lock-in? The Environmental footprint of electronic components manufacturing in Taiwan (2015-2020). Journal of Industrial Ecology, 28, 1212-1226. https://doi.org/10.1111/jiec.13487