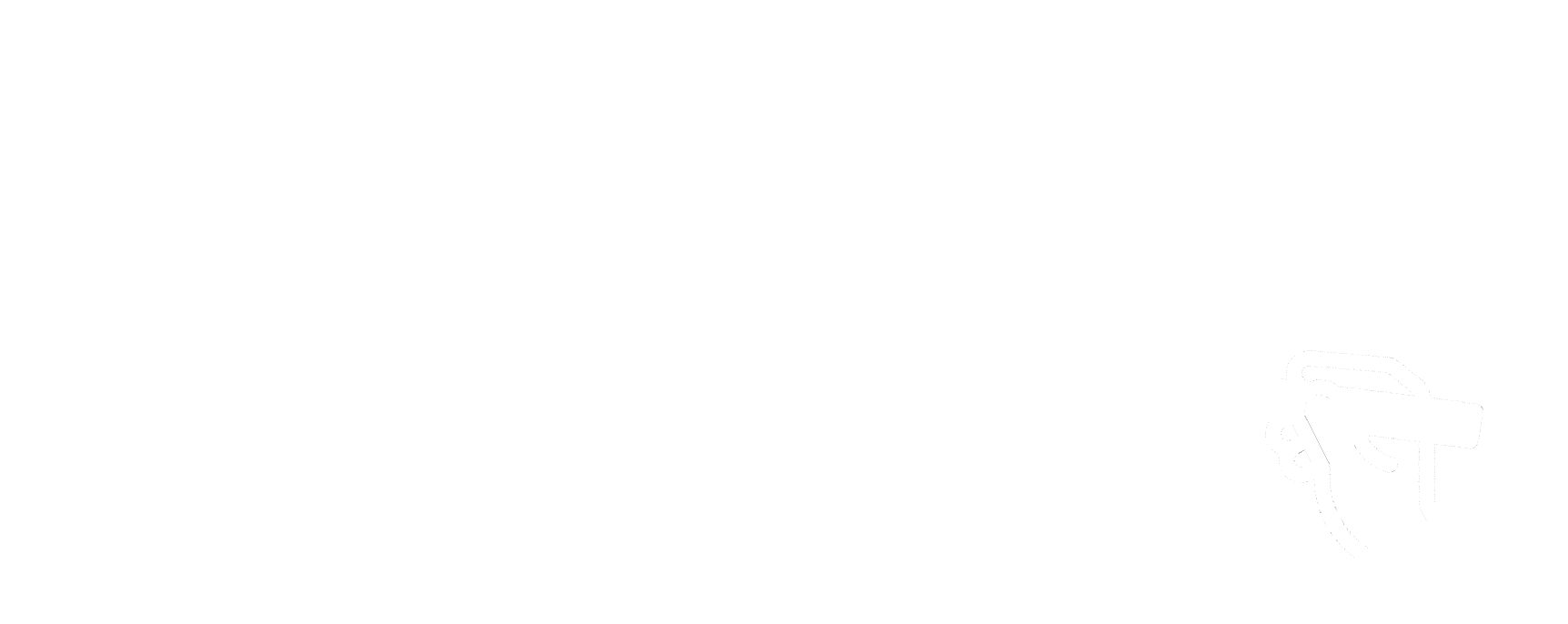Résumé
La notion de transition écologique s’est imposée dans le paysage institutionnel français en 2017, puis rapidement dans de nombreux cursus académiques. L’école Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) forme des ingénieurs et ingénieures de l’aménagement durable des territoires. L’ENTPE, forte d’une tutelle du ministère de la transition écologique, a mis en place un enseignement de 200 h dédié à la transition écologique et solidaire. Cet article détaille la conception et le développement d’un module clef de ce cursus : la création d’un forum étudiant des indicateurs de la transition. Il permet d’amener les élèves à débattre des métriques (statistiques, comptabilités, indicateurs) de la transition devant et avec des élus et élues, et des professionnels et professionnelles. Les indicateurs débattus varient en fonction des années autour d’une liste première : bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES), Analyse en Cycle de Vie (ACV), services écosystémiques, indicateur de santé des sols, Indicateur de Bien-Etre Soutenable et Territorialisé (IBEST), limites planétaires, indicateur de comptabilité écologique (Care), indicateur de santé sociale, évaluation quantitative d’impact sanitaire. Il s’agit pour les élèves d’envisager comment les comptes de la transition sont insérés ou coélaborés dans des programmes d’action publique ou d’entreprises, et de s’interroger : qui les soutient ? Qui les conteste ? Avec quels résultats ? L’enjeu ultime est de saisir qu’aucun compte ne peut s’imposer par sa seule intelligence interne, que chacun dispose de ses qualités et limites, liées à la multiplicité des intérêts contradictoires qui animent une société. Cette compréhension de la pluralité des enjeux doit permettre aux futurs ingénieurs et futures ingénieures de se positionner en conscience et de manière efficace pour favoriser une transition écologique et solidaire de nos sociétés.
1. Introduction
La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) identifie la transformation des systèmes économiques pour la nature et l’équité comme une des cinq stratégies permettant les « changements transformateurs »1 nécessaires pour respecter les engagements mondiaux en faveur d'un monde juste et durable (O’Brien et al., 2025). Il est notamment question de « redéfinir les objectifs, les métriques et les indicateurs pour reconnaître les dimensions sociales (y compris culturelles), économiques et environnementales, ainsi que les différentes valeurs de la nature ».
Pour analyser ou conduire ces changements, des myriades d’outils existent. Mais aucun ne parvient à s’imposer face au standard hégémonique d’évaluation que constitue la valeur monétaire. Tout au contraire, les acteurs économiques dominants maintiennent leurs modes de développement anciens en se contentant d’opérations de green washing voire même en organisant le contournement des normes environnementales (exemple du dieselgate en 2015). Pour tenter de contenir ces comportements, l’union européenne a ainsi voté récemment une « Directive sur les allégations environnementales »7.
Le secteur de l’ingénierie, historiquement liée aux industries qui sont la base des économies carbonées, a fait l’objet de critiques appuyées et suscité les débats, notamment au sein des associations professionnelles. C’est ainsi que la branche britannique de l'association Ingénieurs sans frontières a publié en 2024 un « guide de survie » de la profession d’ingénieur qui souligne notamment les dérives liées au développement d’outils de comptes « verts » dont l’inefficacité, voire la contre-productivité pose d’importants problèmes à l’image et au développement de la profession8. Former les jeunes générations pour dépasser les faux-semblants constitue donc un impératif dans toutes les communautés académiques.
Ce contexte géopolitique global éclaire de manière directe la création en 2023 par l’ENTPE, d’un Forum étudiant des indicateurs de la transition écologique et solidaire. L’ENTPE forme des ingénieurs et des techniciens de l’aménagement durable des territoires, l’école est sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Le forum étudiant s’insère dans un cycle de 200 h d’enseignement du cursus ingénieur dédié aux enjeux de la « transition écologique » (nous allons revenir sur cette notion).
La construction du forum présuppose que l’un des principaux rôles des ingénieurs et ingénieures est de quantifier le monde pour le moderniser, et donc de quantifier aujourd’hui sa nécessaire transition écologique, pour mieux la faire advenir. Le forum constitue une forme pédagogique permettant aux élèves de s’approprier les éléments de débats sur la manière de quantifier la transition. Il s’agit d’installer, au cœur de l’enseignement des ingénieurs, la compréhension que chaque compte est lui-même le fruit de débats et doit être appréhendé dans sa réalité globale, non pas seulement scientifique et technique, mais aussi économique et sociale, ou politique. Compter, c’est d’abord convenir de ce que l’on compte. Une convention qui doit être débattue, en société, en présence de et avec les techniciens de la mesure.
Avant de présenter les dynamiques institutionnelles et académiques qui ont porté la création et l’organisation de ce forum étudiant, nous définissons le terme de « transition ».
1.1. Pourquoi « indicateurs de la transition écologique et solidaire » plutôt que « indicateurs écologiques » ?
La notion de « transition écologique » s’est imposée dans le paysage institutionnel français en 2017, à l’occasion de l’installation, à la tête du ministère jusque-là en charge de « l’écologie et du développement durable », d’un agent alors influent dans le champ médiatique national. Pour le ministre, la nouvelle marque de son administration lui permettait de revendiquer sa volonté de se distinguer des responsables du principal parti politique écologique en s’arrogeant la ligne du rajeunissement, celui en l’occurrence de la notion de « développement durable » qui avait permis trente ans plus tôt d’insérer l’écologie dans l’agenda diplomatique international9.
Si cette notion de transition n’a pas connu, sur la scène internationale justement, le même succès que celle de durabilité, elle est encore le nom, en France, du ministère qui se trouve être en particulier la tutelle d’écoles d’ingénieurs orientées vers le génie civil et l’aménagement des territoires au sens large. Parmi elles, l’École des ponts, connue comme l’une des premières écoles d’ingénieurs au monde du fait de sa création en 1747, mais également l’ENTPE, qui forme quant à elle une grande partie des cadres de cette administration. Déconcentrée à Lyon en 1975, l’ENTPE constitue aujourd’hui l’un des quatre piliers du collège régional d’ingénierie, aux côtés de l’INSA et l’École centrale de Lyon ainsi que de l’École des Mines de Saint-Étienne.
1.2. Les académies en questionnement pour enseigner la transition
Au-delà du champ institutionnel, la notion de transition écologique et solidaire recompose la communauté académique nationale. Le rapport confié au climatologue Jean Jouzel et remis en 2022 à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche a ainsi fixé les orientations souhaitables pour l’évolution des formations en direction de la transition et du développement durable (Jouzel, 2022). En matière de recherche également, un récent ouvrage collectif, porté par plusieurs directrices scientifiques de l’Institut de sciences humaines et sociales du CNRS, comporte un chapitre dédié à la notion de transition écologique, en lien avec les inégalités sociales renforcées par la crise climatique, enjoignant à « penser des transitions qui soient le plus juste possible » (Maljean-Dubois et al., 2024).
Dans le champ des sciences de l’écologie, les scientifiques se questionnent sur leur mode d’engagement dans la société et interrogent leur façon de rendre utiles leurs résultats. Une session spécifique était ainsi consacrée à cette question lors du dernier congrès international de la Société Française d’Écologie et Évolution à Lyon en octobre 2024. La professeure de philosophie autrice d’une « biographie du carbone », Bernadette Bensaude-Vincent, y appela les écologues à communiquer leurs résultats auprès du grand public en y adjoignant les éléments de méthodes et d’hypothèses permettant d’en suivre les raisonnements. Dans cette perspective, des réseaux mêlant expertise et militance se développent comme le « mouvement des villes en transition » lancé depuis l’Angleterre par un spécialiste de permaculture (Rob Hopkins).
1.3. Un cycle de 200 h dédiées à la transition écologique et solidaire
C’est portée par ces dynamiques que la direction de l’ENTPE a engagé en 2022 une refonte du programme de formation de ses ingénieurs. Un nouveau parcours de deux cents heures dédiées à la « Transition écologique et solidaire » a été créé de toutes pièces. Organisé autour de cinq modules ou « unités d’enseignements » de 40 h chacune, il débute par une présentation des enjeux globaux et des fronts de la recherche engagée dans leur direction. Puis, en 2e année, il porte sur ce qui constitue le cœur du métier des ingénieurs : quels savoirs sont nécessaires pour que les ingénieurs d’aujourd’hui puissent participer activement à la transition ?
La communauté académique et professionnelle que rassemble l’ENTPE a été largement mobilisée pour formuler une réponse : la mise en chiffres du monde et sa modélisation. Comment aujourd’hui mettre en chiffres la transition ? Celle des territoires et celle de tous leurs agents économiques et sociaux ? Qui serait susceptible d’assurer notre santé « unique », celle des citoyens et citoyennes, de leurs environnements de vie, et plus globalement des écosystèmes ? La première étape a été de satisfaire aux nouvelles recommandations de la Commission nationale des titres d’ingénieurs (CTI) justement mises à jour en 2021. L’UE « Ingénieur.es transition et sociétés » comporte ainsi un enseignement dédié à l’analyse des cycles de vie et à la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre.
Mais l’innovation pédagogique relatée ici réside dans l’introduction de cette UE « Ingénieur.es, transition et sociétés ». Celle-ci qui prend la forme d’un forum qui invite les élèves ingénieurs à débattre des différents indicateurs de transition parmi tous ceux qui se développent dans divers secteurs d’activité. Cette formule s’inspire de l’historique « Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesses » (FAIR) qui a animé les communautés académiques des sciences humaines et sociales (SHS) depuis sa création en 2008.
L’ENTPE, qui dispose d’une riche tradition de recherche dans ce champ des SHS, reconnue par ses semblables, entretient en particulier un programme de sociologie de la quantification dont la discipline a été au cœur de la dynamique de FAIR, nourrie de l’influence des travaux d’Alain Desrosières. Celui qui est considéré comme le fondateur de ce champ scientifique en France avait coutume de dire que la première étape de la mise en chiffres du monde consistait en une activité de conventionnement : que compter ? Comment ? (Desrosières, 2008). C’est dans cette direction que l’ENTPE a notamment orienté son cursus de master développé avec Sciences Po Lyon en promouvant un programme d’analyse des politiques de la quantification (Bardet, 2014) qui a fourni la base théorique de ce forum.
1.4. Débattre des méthodes de compte pour apprendre à se positionner comme ingénieur de la transition écologique et solidaire
Il a donc été proposé aux élèves de l’ENTPE de préparer et d’animer un « Forum étudiant des indicateurs de la transition écologique et solidaire » pour débattre des qualités et limites de divers indicateurs sélectionnés par l’équipe enseignante. Ils progressent ainsi dans l’acquisition de la compétence « Innover et agir pour mettre en mouvement la société vers la transition écologique et solidaire ». L’objectif est moins d’identifier collectivement quel pourrait être l’indicateur de transformation le plus puissant, que de saisir combien les indicateurs sont liés aux contextes sociaux dans lesquels ils sont produits ou mobilisés.
L’exercice est bien de partir des cadres et ambitions scientifiques de chaque indicateur pour organiser la controverse de manière scientifique et précise. Cet exercice s’opère dans un cadre explicitement interdisciplinaire présenté aux élèves comme un des premiers enjeux de débat. Comment faire discuter ensemble les sciences de l’ingénieur, celles du vivant, de l’environnement, et les sciences humaines et sociales, pour débattre de la qualité de quantifications alternatives de la transition ? Les élèves doivent saisir et se saisir des objectifs de chaque indicateur, et de ses moyens techniques ou de sa notoriété. Ils doivent ensuite appréhender les rapports de force sous-jacents qui animent les champs scientifiques de la controverse, ou les champs politiques de ses acteurs. Un indicateur d’économistes de la Banque mondiale a-t-il plus de chances de succès qu’un indicateur de biologistes universitaires ? Ou d’experts d’un service technique de l’État français ?
Il ne s’agit d’aucune manière de relancer la « guerre des sciences » ou de relativiser l’importance capitale de la science ou de l’ingénierie. Il s’agit au contraire, au cœur de la tradition de l’ingénierie comme science au service de la société, de penser leurs mises en contextes pour permettre leurs transformations ou adaptations, en prenant en compte toutes les composantes des sociétés et de leurs environnements. Pour réaliser intelligemment un bilan des gaz à effet de serre (BEGES) ou une analyse en cycle de vie (ACV), il est primordial de comprendre les origines, les promoteurs, les succès et les limites de ces calculs !
La première édition du forum étudiant des indicateurs de la transition a eu lieu à l’automne 2023 et a rassemblé d’emblée plus de 300 professionnels et professionnelles, et 220 étudiants et étudiantes sous le marrainage de Florence Jany-Catrice. Économiste hétérodoxe de renommée internationale, elle mène depuis des années des travaux sur les indicateurs alternatifs de richesse, dans un sillage proche de celui de Desrosières.
Forte de ce succès, la seconde édition du forum a été intégrée au programme off des Journées d’économie de Lyon (JECO)10 et a fait l’objet d’un approfondissement des méthodes de préparation des débats, lequel a abouti à une organisation et une formalisation des échanges qui constituent le véritable succès de cet enseignement. Il est proposé d’en faire ici le récit dans la perspective de son élargissement ou de sa reproduction.
2. Organisation pédagogique
À l’issue de ces deux premières années de réalisation, le forum étudiant de l’ENTPE a stabilisé sa forme autour de plusieurs modules correspondant à 15 h d’enseignements répartis sur 6 semaines : 3 h d’introduction en cours magistral, 4 × 2 h de tutorat préparatif, 3 h de forum où se tiennent les débats et 1 h de forum général conclusif.
Le contenu de l’amphi d’introduction est présenté ici. Il comporte des éléments transposables à tout contexte académique, et des éléments plus spécifiques à l’ENTPE. Sont aussi présentés les modules de préparation au forum, à la fois théoriques et organisationnels. Ils constituent les éléments essentiels de ce cours, utiles pour d’éventuelles adaptations dans d’autres contextes académiques.
Mentionnons que ce texte est rédigé alors que son autrice et son auteur travaillent à une internationalisation du forum, à l’occasion de la tenue à venir de la COP30 en novembre 2025 à Belém au Brésil, en partenariat notamment avec des collègues brésiliens ou plus largement liés à des centres universitaires étrangers. Cet aspect fera l’objet d’une ouverture en conclusion de ce texte.
2.1. Introduction de l’unité de cours
La forme académique de l’amphithéâtre est historiquement celle de l’université, lorsque dans les écoles d’ingénieurs, les formats restreints et expérimentaux sont largement préférés par les élèves (type travaux dirigés). Mais un « forum », c’est d’abord le partage et la discussion tous ensemble, objectifs premiers de ce module pédagogique adressé à des élèves qui parfois peuvent nourrir l’idée que la « rationalité » doit s’imposer sans le débat ! Un « amphithéâtre d’introduction » s’est donc imposé comme l’impérative mise en œuvre immédiate des principes et méthodes de travail qu’il s’agissait de transmettre aux 220 élèves de la promotion accueillie en 2024.
Cette introduction a été pensée la plus courte possible pour permettre aux étudiants de relier l’exercice proposé avec les notions qu’ils ont vues précédemment et d’en comprendre les intentions. Elle débutait par un bref rappel des principaux enjeux environnementaux de la société (réchauffement climatique, inégalités de responsabilités, inégalités territoriales environnementales, sociales et sanitaires, érosion de la biodiversité, enjeux démocratiques associés au partage de la connaissance), qui permit de déboucher sur une proposition de définition de la notion de « transition ».
Se doter d’une définition partagée de la transition écologique et solidaire
Cette définition de la transition avait été élaborée au sein de l’équipe pédagogique, favorisant d’emblée l’interdisciplinarité : « Penser, vivre et conduire les changements sociétaux nécessaires pour aller vers des sociétés dont les modes de production et les modes de vie prennent en compte la finitude des ressources naturelles et les équilibres environnementaux et en s’assurant de garantir la justice entre les territoires, les générations et le vivant ».
- « penser » = comprendre, s'approprier, mettre en récit.
- « vivre » = l'ingénieur ou ingénieure / le ou la scientifique / le ou la fonctionnaire n'est pas en dehors du monde, il vit dedans, il est une partie du problème et de la solution, donc, il doit vivre les changements. --> expérimenter.
- « conduire » = en tant que sachant, l’ingénieur scientifique doit par des outils, des méthodes, de la mise en dialogue, de la communication participer à entraîner avec lui le reste de la société. --> faire ensemble.
- « de sociétés » : la démarche de transition doit être mondiale mais toutes les sociétés n'ont pas le même chemin à faire, donc pas toutes la même transition. --> présenter les inégalités mondiales en termes de responsabilités environnementales et en termes de vulnérabilités aux impacts environnementaux.
- « changements sociétaux » = changements culturels (mode d'utilisation et répartition des matières et de l'énergie, relations interpersonnelles...) --> discussion autour de la notion de sobriété.
- « nécessaires » = car sans cette transition, la vie humaine sur terre sera compromise --> à documenter à partir des rapports du GIEC par exemple.
- « justice entre les territoires, les générations et le vivant » = notion de climax en écologie, concept de One Health, très proche de la conception portée par Joyeeta Gupta, qui fait largement référence dans le domaine.
Pour parvenir à cet objectif, des stratégies de restauration seront nécessaires car des limites planétaires ont déjà été franchies.
Dans un deuxième temps, il est présenté la raison d’être du forum des indicateurs de la transition, très directement liée au cœur même de l’activité des ingénieurs qui sont en charge de quantifier le monde, en lien avec les autres corps de la société qui sont susceptibles de mobiliser ces quantifications pour planifier et organiser sa modernisation.
Pour quantifier le monde, avant de le mesurer, il faut se mettre d’accord sur ce qu’on compte et comment !
Cette déclinaison de la formule d’Alain Desrosières maintes fois reprise (« Quantifier : c’est convenir puis mesurer ») permet d’insister sur ce qui fait le sens du forum de l’ENTPE, comme c’était celui de la fondation de l’école de sociologie de la quantification qu’il opéra : toute quantification du monde commence par la convention, l’accord entre les différentes parties prenantes du problème, ou entre les différents représentants de la société lorsque le problème est global.
Desrosières fut le premier à établir aussi clairement que la quantification du monde est politique. Non pas politique au sens partisan, comme lorsque certains affirment que les chiffres sont « truqués », mais politique au sens le plus large du terme : les chiffres sont une affaire citoyenne qui ne peut pas être laissée aux seuls spécialistes, même si les spécialistes doivent avoir leur mot à dire, et qu’il est important de les entendre pour ne pas raccourcir ou déformer les problèmes qui se posent.
Prenons un exemple simple et connu qui démontre que la quantification du monde constitue une politique à part entière qui mérite toujours un débat citoyen : le décompte des populations d’un pays, ce qu’on appelle le recensement. À première vue, compter des personnes n’apparaît pas si compliqué : on ne connaît plus de débats « philosophiques » sur ce qu’est une « personne » (depuis que l’esclavage a été aboli, puisqu’au lancement des premiers recensements justement, le décompte des esclaves faisait question)11. Mais, même sans discussion sur la définition de l’objet du décompte, l’opération de comptage des populations à l’échelle d’un pays est d’une complexité infinie.
Elle prend tant de temps que beaucoup de naissances, de morts ou de changements d’adresse interviennent entretemps, rendant la sommation délicate. À quoi il faut ajouter les résistances légitimes et nombreuses à se laisser compter, surtout dans les populations qui ont acquis la conviction qu’elles ne comptent pas dans les affaires gouvernementales, ou plus encore chez les personnes qui sont dans des situations d’irrégularité juridique… De sorte que les spécialistes du recensement ont établi de longue date qu’il était plus précis de réaliser des sondages des populations (Bardet, 2007) ! La supériorité du sondage pour réaliser les opérations de recensement est tellement contre-intuitive qu’elle n’a jamais été acceptée aux États-Unis pourtant souvent donnés en exemple de démocratie, comme une historienne l’a expliqué de manière magistrale (Anderson, 2015).
Comment se compte la transition ?
Les choses sont donc naturellement plus compliquées encore pour la question de la « transition », à de nombreux titres. D’abord et avant tout parce que la transition est un objectif d’action publique et non pas un état de fait.
Dans cette perspective, les scientifiques font assaut d’ingéniosité pour trouver l’objectif qui pourrait s’imposer à tous, et les mesures associées. Et à l’intérieur du champ académique, les visions disciplinaires diffèrent, notamment entre biologistes ou naturalistes qui cherchent d’abord à décrire le monde, et les académiques d’ingénierie qui veulent avant tout le transformer.
L’indicateur de la température terrestre s’est imposé en premier lieu, depuis plusieurs décennies à l’échelle internationale, aux côtés également de celui de la biodiversité, plus complexe à mesurer. Mais une fois la température retenue comme indicateur premier, quelle quantification promouvoir pour permettre de contenir son élévation ? Les comptes du carbone ont pris un net avantage. Ce furent d’abord les travaux préparatoires au protocole de Kyoto. Puis l’initiative de l’Union européenne pour mettre en place un marché des droits d’émissions (Aykut, 2014). Mais les imperfections ou les tricheries liées aux comptes du carbone ont fragilisé les dynamiques (Valiergue, 2020).
L’amphithéâtre d’introduction du forum fut ainsi l’occasion de dresser un rapide historique de l’institutionnalisation de ces quantifications à l’échelle internationale d’abord. Ce fut d’abord la question de la mesure de la pollution atmosphérique et des pathologies ou de la mortalité associées pour permettre de nouvelles législations restrictives en direction des industries les plus polluantes, en Angleterre et en France notamment (Boullet, 2006). Une étape importante fut ainsi franchie avec la convention internationale de 1979 qui normalisa la méthodologie de décompte des émissions de polluants (European Environment Agency, 2023).
Beaucoup plus récemment, et dans le prolongement des dynamiques des comptes carbone favorisés par les COP climat depuis les années 1990, l’agence environnementale de l’ONU a également poussé au développement de la plateforme IPBES au début des années 2000, pour le suivi de la biodiversité et des services écosystémiques associés (Daccache, 2011).
Dans tous ces cas, la même séquence se reproduit sur laquelle nous avons attiré l’attention des élèves : observation et émergence d’un problème public, inscription du problème à l’agenda d’une institution publique nationale ou internationale, rassemblement des parties prenantes et de différentes expertises pour définir un programme d’action et les outils de sa mise en œuvre. Autant d’étapes qui démontrent que les quantifications du monde sont des politiques qui doivent être élaborées avec leurs parties prenantes pour être légitimes et opérantes.
Par-delà ce cadre théorique présenté aux élèves, l’intérêt majeur de ce module réside dans l’architecture de la préparation des élèves au forum. Rendre explicite cette organisation constitue selon nous le principal intérêt de ce papier, susceptible de permettre la diffusion de ce format d’enseignement. Nous expliquons d’abord le choix des indicateurs retenus pour permettre la mise en débats, puis la conception des modules de préparation à la connaissance de ces indicateurs, et enfin l’organisation du débat institutionnalisé, le « forum » à proprement parler.
2.2. Les méthodes de compte mises en débats
Lors de la 2e édition du forum, six méthodes de compte (en partie renouvelées) ont été sélectionnées pour être présentées et mises en débat. Au cours des deux éditions du forum, en tout neuf méthodes ont été abordées (tableau 1). La sélection s’est opérée par choix pédagogique en lien avec la définition posée de la transition. Le nombre de méthodes sélectionnées devait ne pas être trop élevé pour permettre à chaque groupe d’élèves en charge de la promotion de chaque indicateur de disposer d’un temps de présentation suffisant au moment des débats, et pas trop faible pour permettre une couverture assez large des types d’indicateurs possibles.
Le choix réalisé par l’équipe pédagogique de ces 6 indicateurs a pu être contesté par quelques élèves qui ont pu exprimer leur regret de ne pas pouvoir défendre un indicateur qu’ils auraient choisi. Chaque année, les 6 indicateurs retenus sont constitués, de manière explicitement partagée avec les élèves, de 3 paires qui renvoient à 3 champs disciplinaires : les sciences de l’ingénieur (BEGES et ACV), les sciences de l’environnement (EQIS et santé des sols) et les SHS (prise en compte économique des services écosystémiques et Indicateur de santé sociale). Ceci offre la possibilité d’un double niveau de débat : entre les groupes présentant des indicateurs d’un même champ disciplinaire, les objectifs y sont proches, et plus globalement, à l’échelle du forum.
| Nom de la méthode | Nom détaillé | Référence | Spécialiste | Intérêts pédagogiques | Édition du forum |
|
Bilan Carbone |
Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) |
L’association pour la transition Bas Carbone (ABC) |
Jean-Claude Morel, directeur de recherches en génie civil à l’ENTPE, spécialiste des matériaux premiers (terres crues, pierres sèches, …) |
CCNUCC- protocole de Kyoto. |
1, 2 |
|
Une méthode incontournable des politiques de décarbonation. |
|||||
|
Prérequis au pilotage d’un plan de transition. |
|||||
|
Obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes en France |
|||||
|
ACV |
Analyse en Cycle de Vie |
Norme ISO 14040 (ISO, 2006) |
Zoé Iannuzzi, doctorante en sciences de l’environnement associée au LEHNA à l’ENTPE et à l’INSA de Lyon |
Économie circulaire. |
2 |
|
Analyse des flux physiques de matière et d’énergie associés. |
|||||
|
Pilotage de diminution des impacts environnementaux multiples de process de production. |
|||||
|
Services écosystémiques |
Évaluer les coûts associés à l’érosion de la biodiversité : Présentation de l’approche par la « valeur » des services écosystémiques potentiellement détruits |
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005 ; Ministère de la transition écologique, 2020) |
Sarah Talandier Lespinasse, Directrice de projet Économie, Biodiversité, Climat |
Évaluation socio-économique des projets d’investissement publics. |
1, 2 |
|
Cerema |
Monétarisation des gains ou destructions en nature. |
||||
|
Valeur tutélaire. |
|||||
|
Valeur économique totale. |
|||||
| CARE | Comptabilité Adaptée à la Responsabilité Environnementale | (Richard, 2012) |
Siham Moulali Gaton, contrôleuse de gestion à la Métropole de Lyon en charge du développement des budgets verts, trésorière du Cercle des comptables environnementaux (CERCES) |
Comptabilité socio-environnementale dite forte (conservation de chaque type de capitaux) et aujourd’hui présentée comme installée sur un principe de double matérialité (compatible avec le modèle défendu par l’UE à travers sa directive CSRD de 2022) et opposé au modèle de l’ISSB présidé par E. Faber depuis 2021, ou à celui de l’Epargne véritable de la Banque Mondiale, lui compatible avec la notion de services écosystémiques. |
1 |
|
EQIS PA |
Évaluation Quantitative d’Impacts Sanitaires – pollution de l’air |
Guide pour la réalisation d'une évaluation quantitative des impacts sur la santé (EQIS) (Corso et al., 2019) |
Jean-Marc Yvon, ingénieur épidémiologiste |
Programme de surveillance de l’air et la santé depuis 1996. |
1, 2 |
|
Cellule Auvergne-Rhône-Alpes |
Consensus autour de la santé. |
||||
|
Direction des régions |
Modèle concentration risque issu de méta-analyses d’études épidémiologiques. |
||||
|
Chaine de modélisation : trafic - air – santé. |
|||||
|
Limites planétaires |
Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet (Dassibat, 2024 ; Steffen et al., 2015) |
Quentin Dassibat, docteur en sciences de l’ingénieur associé au laboratoire EVS à l’ENTPE, spécialiste de la territorialisation du modèle des limites planétaires |
Indicateur récent. |
1 | |
|
Développé par des chercheurs en sciences de l’environnement. |
|||||
|
Définition de 9 limites bio physico chimiques de la planète. |
|||||
|
Un outil pour faire une analyse de risques que les perturbations engendrées par les humains déstabilisent le système terre à une échelle planétaire. |
|||||
|
Santé des sols – Muse |
Multifonctionalité des sols – intégrer la qualité des sols dans les documents d’urbanisme |
(Branchu et al., 2022) |
Fabienne Marseille, Directrice de projets Stratégie foncière, Cerema |
Transfert des résultats d’un projet de recherche grâce un consortium d’acteurs. |
2 |
|
Territoires pilotes. |
|||||
|
Lien fonctions écologiques et document d’urbanisme. |
|||||
|
ISS |
Indicateur de santé sociale |
(Jany-Catrice et Zotti, 2009) |
Félicien Pagnon, docteur en sociologie, chercheur associé à Kedge business school |
Un indicateur co-produit par la société civile. |
2 |
|
Dimensions de l’indicateur : éducation, logement, santé, revenus, travail et emploi, lien social, justice. |
|||||
|
Indicateur territorialisé. |
|||||
|
Ibest |
Indicateur de bien-être soutenable et territorialisé |
(Delahais et al., 2023) |
Hélène Clot, Directrice stratégie, innovation et relations citoyennes Grenoble-Alpes Métropole |
Indicateur territorialisé. |
1 |
|
Une approche capacitaire du bien-être. |
|||||
|
8 dimensions : temps et rythme de vie, bien de subsistance, travail et emploi, affirmation de soi et engagement, démocratie et vivre ensemble, environnement naturel, santé, accès et recours aux services publics. |
|||||
|
Observatoire. |
|||||
|
Portage par une collectivité. |
2.3. Se préparer à débattre : organisation et montée en compétences des groupes en 4 séances de 2h
Les 220 élèves ont travaillé à la préparation du forum en étant répartis en dix « classes » rassemblant chacune 20 à 23 élèves. Au sein de chaque classe, les élèves ont été répartis en 8 binômes ou trinômes (Tableau 2). Six se sont vus confier l’appropriation des connaissances des méthodes d’un indicateur dans la perspective de sa défense le jour du forum, un septième la charge de la préparation de l’animation du débat et le huitième celle de la coordination de la production d’une synthèse communicante des connaissances et du secrétariat des débats.
À la suite de l’amphithéâtre d’introduction, quatre séances de préparation du forum, de deux heures chacune, sont proposées. Leur contenu est de deux types : deux séances sont consacrées à des présentations approfondies des indicateurs par des spécialistes, dans lesquelles les élèves sont répartis en fonction des indicateurs pour lesquels ils ont été désignés. Leur contenu est détaillé ci-après. Les deux autres séances, dans lesquelles les élèves se retrouvent dans leur « classe » (séance 2 et 4) ont vocation à les préparer à mener un débat. Ces séances sont supervisées par des chargés de tutorat. La séance 2 est un tutorat « argumentation ». Il met les étudiants dans une situation d’observation d’un débat et d’identification des rôles tenus, et propose un rappel de méthodes utiles pour argumenter un propos. La séance 4 est une répétition des débats par les élèves visant à les finaliser et les améliorer.
|
Rôle |
Débatteurs |
Animateurs/trices |
Secrétaires |
|
Nombre de binôme ou trinôme d'élèves / groupe |
6 |
1 |
1 |
|
Éléments de préparation spécifique |
2 × 2 h avec les spécialistes des méthodes |
Échanges avec un animateur expert (méthode pour structurer le débat) |
Tutorat pour vision transversale des indicateurs |
|
Rôle le jour du forum |
Présentation et argumentation sur l'utilité d'une méthode de compte / transition |
Introduction du débat (contexte, participants, problématique) |
Relevé des 3/4 éléments saillants des débats |
|
Animation (questions, relance, modération) |
Transmission pour le forum général |
||
|
Production écrite (possiblement évaluée) |
Fiche de présentation de l'indicateur et arguments |
Rédaction de l'introduction et programme des débats |
Plaquette de présentation des 6 indicateurs > communication |
Accompagnement et production attendue des groupes de débatteurs
Les élèves « débatteurs » ont bénéficié de deux séances de face-à-face pédagogique avec les spécialistes des méthodes de compte (tableau 1). La séance 1 a consisté en un cours expliquant l’indicateur étudié incluant : le contexte de développement de la méthode, l’éventuel portage réglementaire et institutionnel, les contraintes techniques de calcul, de référence, de validité, les intérêts et limites à l’horizon de la transition.
À la suite de cette séance, les élèves ont eu à produire une fiche d’analyse de l’indicateur (voir les documents complémentaires disponibles sur le site du journal). Cette fiche permet la synthèse, la restitution des éléments concernant l’indicateur et la mise en place du scénario du débat. Elle leur est utile en support de leur prise de parole. Il était attendu qu’elle contienne les éléments suivants : i. présentation de l’indicateur (origine, mode de calcul, données sources, unité de compte, périmètre d’analyse), ii. un exemple d’utilisation, iii. les utilités, forces, difficultés ou limites de l’indicateur, iv. argumentation : principal intérêt de cet indicateur par rapport aux objectifs de transition écologique et solidaire, autres arguments, v. ressources bibliographiques et ressources documentaires explicitement distinguées pour inviter les élèves à considérer la différence entre littérature scientifique ou grise.
Cette fiche d’analyse est ensuite corrigée par le ou la spécialiste en amont du forum pour permettre à chaque élève l’approfondissement de la réflexion. Elle constitue un support possible de l’évaluation du module. Elle est améliorée par les élèves débatteurs lors de la séance 3 (seconde séance avec les spécialistes des méthodes).
Accompagnement et production attendue des groupes d’animateurs et de secrétaires
Les élèves en charge de l’animation du débat ou ceux ou celles en charge de produire des éléments de synthèse ont de leur côté besoin d’acquérir une vision d’ensemble des indicateurs et de se familiariser avec des questions qui vont au-delà de ces métriques.
Ils bénéficient à ce titre d’un accompagnement spécifique. Dans la séance 1, ils ont tout d’abord la possibilité de circuler à leur gré entre les présentations thématiques. Dans la séance 3 ensuite, ils ont bénéficié lors de la deuxième édition de l’accompagnement d’un collègue chercheur spécialiste des modèles économiques de production de la ville et organisateur régulier de débats publics, Alexandre Coulondre, qui les a guidés dans l’organisation méthodologique à mettre en place pour préparer un débat. Les élèves concernés ont ainsi été invités à se rapprocher de leurs collègues débatteurs pour connaître en amont du débat leurs analyses et stratégies, afin de construire et renseigner une grille de questionnement applicable à tous les indicateurs.
L’ensemble des élèves animateurs ou secrétaires ont également été sensibilisés à l’importance de contextualiser le forum, tant pour faciliter les échanges entre leurs différents collègues débatteurs, que pour rendre explicites et efficaces les supports de communication papier susceptibles d’être diffusés à l’issue du forum.
Dans le but d’éviter des présentations répétitives ou platement juxtaposées, les élèves ont été invités à structurer le débat autour de trois ou quatre angles de questionnement qu’ils devaient définir et sur lesquels inviter les débatteurs à intervenir. Cette pluralité de questionnement permet de faire émerger les différences et les complémentarités des méthodes et des indicateurs débattus.
La recherche d’un débat équilibré entre les représentants des différentes méthodes a fait l’objet d’un développement particulier.
Concernant les élèves « secrétaires de séance », l’importance de la notion de « secrétariat » a d’abord été soulignée, en écho avec son étymologie (dans le secret des autorités) mais également en lien avec le pouvoir du secrétariat d’écrire l’histoire d’une certaine manière, arbitrant ce qui sera retenu des échanges oraux. À l’issue des débats tenus dans les dix forums organisés en parallèle pour toute la promotion, les élèves secrétaires ont alors la mission de relever trois à quatre points saillants, sur le fond et la forme des débats, pour les transmettre dans la seconde partie de la journée qui constitue la plénière du forum.
Les productions attendues de ces groupes transversaux dépendent des productions des groupes spécialisés sur les méthodes. Il a été demandé à ces groupes d’adopter une posture de coordination et d’organisation du travail collectif. L’équipe pédagogique a veillé à ce qu’ils/elles soient bien installés dans cette posture à l’échelle de la « classe » et en direction de l’ensemble de la promotion.
Les trinômes d’animation et de secrétariat permettent ainsi pour les premiers la production d’un discours d’introduction et d’un déroulé de débat problématisé, et pour les seconds la production d’une plaquette de présentation synthétique des indicateurs à destination des externes invités pour la plénière du forum (A4 recto/verso). Ces productions ont été corrigées en vue d’amélioration par le chargé du tutorat de la classe. Ces productions constituent un support possible de l’évaluation du module.
3. Un forum à plusieurs enceintes : étudiants, professionnels et élus débattent des comptes de la transition
Les 17 novembre 2023 et 5 novembre 2024 se sont tenues les deux premières éditions du forum étudiant des indicateurs de la transition écologique et solidaire de l’ENTPE.
Comme cela a déjà été présenté, le forum s’organise, le jour-J, en deux temps : un premier temps de débats en petits groupes dans la configuration dans laquelle les élèves ont répété, devant et avec les élus et professionnels associés, sur un temps long (9h30-12h) qui permet des débats argumentés et incluant le maximum d’élèves, puis un temps collectif plus réduit (30 min), en amphithéâtre, qui permet de mettre en lumière les difficultés inhérentes au fait de rapporter en séance plénière des points travaillés en petits groupes. Sur les deux éditions, environ quatre-vingt invités professionnels et élus sont venus entendre et débattre avec les élèves ingénieurs, tout au long des deux temps de la matinée.
3.1. Quelques échos des forums étudiants
Quelques exemples de problématisation du débat par les animateurs : « En quoi ces indicateurs sont pertinents pour œuvrer à la transition écologique et solidaire ? Quels indicateurs choisir pour mesurer la transition écologique de manière juste en tenant compte des diversités sociales et économiques ? En quoi la prise en compte de plusieurs indicateurs est-elle nécessaire à une meilleure compréhension et mise en œuvre de la transition écologique ? »
Et quelques exemples de questionnements amenés dans le débat : « Quel est le coût financier de votre indicateur ? Est-il important oui ou non ? Rapide tour de table. À quel point le coût d’un indicateur doit-il être pris en compte pour son application ? Quels sont les outils que nous pouvons mettre en place pour quantifier les bénéfices écologiques sur le long terme afin de justifier ces investissements ? Dans les faits, pensez-vous que votre indicateur peut avoir un réel impact visible à l’échelle d’un département ou d’une région ? Quels mécanismes de suivi temporel pouvons-nous mettre en place pour garantir la durabilité et la pertinence continue de ces indicateurs dans le temps ? Comment l'innovation technologique peut-elle améliorer la précision et la pertinence de ces indicateurs au fil du temps ? Qu’est ce qui manque à votre indicateur et quel autre indicateur pourrait compenser cette faiblesse ? Doivent-ils être mis en place par l'État, les entreprises ? Quel indicateur peut être utilisé par le plus d’acteurs ? Les données pour chaque indicateur sont-elles faciles à trouver et à exploiter ? Quelles actions pourraient aider votre méthode à s’imposer ? Comment les indicateurs utilisent-ils les données et quels sont leurs impacts sur la compréhension des enjeux de la TE ? Comment des inclusions différentes de l’environnement dans les indicateurs peuvent-elles influer sur leur objectif ? Avons-nous une dette envers la nature ou la nature doit-elle quelque chose à l’humanité ? En quoi les échelles de travail et d’impact des indicateurs sont-elles déterminantes pour les résultats ? »
« Quelle est l'importance des cibles des indicateurs, des formes et de l’institutionnalisation des résultats pour leurs lectures et leurs applications ? Comment prendre en compte les influences et les intérêts des acteurs au sein des indicateurs ? »
Les points saillants des débats matinaux remontés en session plénière par les secrétaires portaient sur la complémentarité des indicateurs, les enjeux énergétiques, sanitaires et environnementaux ciblés, la question de l’échelle de portée des indicateurs (commune, région, France) et la question de la transposition internationale des méthodes, la question des sources de données, de complexité de prise en main et de compréhension des méthodes, de l’influence de certains acteurs économiques dans la définition des méthodes et de la nécessité d’offices de contrôle, enfin il fut question des coûts de mise en œuvre de ces comptes.
3.2. La session plénière
L’organisation de la session plénière a fait l’objet pour la deuxième édition du forum d’une organisation retravaillée. Elle a bénéficié de la mobilisation d’élèves enthousiastes après leur participation à la première édition du forum et qui ont proposé de s’investir dans son organisation, notamment pour faciliter l’engagement des élèves dans la séance plénière, souvent moins participative.
Les cinq étudiantes mobilisées à nos côtés pendant toute la préparation de cette seconde édition se sont ainsi vu confier l’organisation de cette plénière. Elles ont conservé l’idée de permettre d’abord un retour sur les forums matinaux comme c’était déjà le cas lors de la première édition, en confiant la parole aux secrétaires. Elles ont ensuite alimenté les débats en versant leurs propres analyses forgées sur la base de leurs participations passée et nouvelle, en proposant justement une mise en perspective des dynamiques distinctes des débats en fonction des promotions d’élèves. Elles ont ensuite donné la parole à un chercheur étranger spécialiste des questions de transition, Fabio Zuker, docteur de l’université de São Paulo et spécialiste des phénomènes de changement climatique liés à la déforestation massive dans les régions de l’Amazonie et ses zones frontières du Cerrado tropical.
L’ensemble de ces prises de paroles s’est déroulé sous le regard attentif de la marraine du forum, Florence Jany-Catrice, spécialiste reconnue à l’échelle internationale sur ces questions de politiques alternatives de la quantification du monde. Comme lors de la première édition, elle a pu offrir son commentaire sur la nature et la forme des débats, avant de proposer une conférence sur les politiques alternatives de mesure de l’inflation, sujet emblématique de débats tus par les champs de l’économie et de la gestion des affaires publiques soumis à l’orthodoxie financière mondiale.
Il est possible de visionner la session plénière sur la chaîne youtube de l’ENTPE (https://www.youtube.com/watch?v=987NeGx9MwY&list=PLXMj2akDurSwL-47NCQWGEoz430rlHrTw).
3.3. Un format qui séduit étudiants et professionnels
De manière déterminante, l’exercice conduit par les élèves démontre que la forme « forum » parvient à remobiliser des connaissances des enjeux environnementaux et sociaux vues en amont et à transmettre de manière efficace les résultats du champ scientifique de la sociologie de la quantification: les données ne sont jamais données et les quantifications sont des opérations qui représentent des politiques à part entière nécessitant de commencer par une phase de conventionnement pour l’orientation des comptes. Les élèves ont ainsi constaté et débattu les complémentarités fréquentes entre les indicateurs sélectionnés, différentes selon les enjeux ciblés (énergie, santé ou environnement), les échelles territoriales d’utilisation (communes, département et pays), souvent liées à des questions d’applicabilité. Ils ont aussi soulevé les enjeux d’ouverture des données utilisées, les difficultés d’appropriation par tous de certains indicateurs, ou encore sur l’implication de certaines communautés professionnelles dans la construction de certains indicateurs et la nécessité de certains processus de contrôle. Autant de questions qui animent les communautés de quantificateurs, statisticiens au premier chef (Desrosières, 2003).
Le format du forum a été très apprécié des élèves, ainsi qu’en témoigne ce verbatim extrait des rapports d’évaluation remis à l’administration : « très intéressant et très vivant avec un riche échange avec les acteurs du secteur. Les notions avaient envie d'être apprises afin de produire un forum pertinent », « Le forum est un très bon évènement, bien organisé et intéressant. Travailler sur les indicateurs permet d'élargir la vision que l'on peut avoir en allant au-delà de simplement Bilan Carbone et ACV » ; « Le format du forum était sympa et j'ai bien aimé le fait d'avoir des experts sur nos sujets » ; « forum superbe ! ». « J'ai beaucoup aimé la première partie avec le forum des indicateurs. Le fait d'être acteur et de faire un débat était très constructif et intéressant » ; « Le format d'un forum est vraiment bien, on peut réellement participer tout en apprenant ».
Il est intéressant également d’évoquer le témoignage d’étudiantes de niveau M2 qui, de leur propre initiative, ont décidé d’accompagner les équipes enseignantes dans la préparation de la 2e édition du forum : « On est en train de passer des entretiens en ce moment pour des stages de fin d’étude, et les bureaux d’études et les entreprises sont en train de s’interroger sur comment mesurer autrement, comment changer les choses. Et c’est à nous en tant qu’ingénieurs d’être moteurs, d’être force de proposition. » « Comprendre les indicateurs nous permet de porter un regard éclairé et nuancé sur les données qui nous entourent, que ce soit dans les domaines de l’environnement, de la société ou de l’économie. Et c’est cette capacité d’analyse critique de la société et de son fonctionnement qu’on souhaite retenir et emporter avec nous dans nos métiers futurs. »
Une mise en perspective problématique et méthodologique qui a plu aussi aux professionnels/professionnelles et élus/élues aguerris à l’utilisation et à la contestation des chiffrages qui ont participé au forum et qui ont adressé aux enseignants des courriers partageant leur intérêt : « Les travaux réalisés par les élèves-ingénieurs de l’ENTPE sur les différents indicateurs sont une source d’inspiration pour les responsables politiques en charge d’organiser et de financer lesdites transitions » ainsi qu’a tenu à le souligner un des vice-présidents de la Métropole de Lyon investi depuis le départ dans la tenue de ce forum. D’autres ont témoigné de leur souhait que cet exercice soit reproduit dans leurs propres communautés professionnelles. Les pistes de développement pour la communauté académique mobilisée dans l’organisation de ce forum apparaissent nombreuses.
4. Les perspectives : ancrage socio-économique, biodiversité et internationalisation
Plusieurs perspectives de développement s’offrent pour ce forum à l’heure où ce texte est écrit. On peut en lister trois principales. Il faut mentionner d’abord la nécessaire pérennisation des dynamiques créées au sein de l’École, en lien avec les autres écoles ou universités, ou avec les partenaires à la fois institutionnels ou du secteur privé. En leur cœur, on peut sans doute placer l’importance des relations interdisciplinaires que ce forum favorise, ainsi que le lien avec les Journées de l’économie (JECO) qui permettent un ancrage dans la vie économique et sociale du territoire d’implantation de l’École.
Sur le plan scientifique, deux projets sont en lien avec nos domaines de recherche : le souhait d’intégrer un autre indicateur de biodiversité, et celui de réintégrer la comptabilité CARE.
Mais l’agenda 2025 place également au cœur des enjeux de développement du forum celui de son internationalisation. Car, partout dans le monde, celles et ceux qui aménagent les territoires ou qui conduisent des politiques, s’interrogent sur les méthodes à utiliser pour intégrer les changements globaux, s’y adapter et gagner en soutenabilité. Le récent rapport de l’IPBES sur le nexus analysant les interdépendances entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation, la santé et le changement climatique (McElwee et al., 2024) identifie bien la nécessaire coopération entre acteurs (gouvernements, société civile, peuples autochtones, secteur privé…) pour mettre en œuvre les solutions.
Comme certains partenaires économiques de l’ENTPE l’ont mentionné notamment au conseil de perfectionnement du cycle ingénieur, les projets qui se mettent en œuvre à l’international portant une dimension de transition écologique se font toujours avec la prise en compte des dimensions culturelles et sociales associées. Il est important que les étudiants soient conscients et préparés à ces aspects.
L’ouverture à l’international de ce forum pourra participer à cette ouverture et à cet apport pédagogique. Une évocation a déjà été faite de cette dimension en introduction. Dans le cadre de la création du nouveau Centre international de recherche « Transitions » du CNRS à São Paulo et de la tenue de la prochaine COP à Belém au Brésil en novembre 2025 s’est bâti le projet de développer un pan brésilien à l’organisation de ce forum, au sein de l’université de São Paulo (USP). Une activité d’expertise publique (actividade de extansão) a été créée au sein de la Faculté de droit de l’université, par la professeure Ana Maria Nusdeo, spécialiste du droit international de l’environnement. Cette activité, ouverte à toutes facultés de l’USP, s’installe d’emblée dans la perspective d’interdisciplinarité qui est au cœur du projet pédagogique.
À la différence de ce qui s’est développé côté français, l’initiative imaginée côté brésilien porte sur une mise en débat des comptabilités vertes des entreprises (notamment à travers des critères dits ESG en référence aux normes ESG : Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Cette orientation vers les indicateurs privés de la transition a été favorisée par les dynamiques de préparation de la COP 30 au Brésil qui ont notamment permis un rapprochement des équipes enseignantes mobilisées avec le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dont l’un des représentant influent, Marcelo Behar, est un ancien étudiant de la faculté de droit de l’USP. Cette dynamique a aussi bénéficié de l’impulsion du cabinet de ce directeur, emmené par Davi Neustein et directement impliqué dans l’implication de son patron dans la discussion des métriques de la transition.
L’ENTPE propose ainsi de mobiliser ses partenaires brésiliens pour engager un collectif d’étudiants internationaux dans le dialogue autour des méthodes de compte de la transition. L’ENTPE recevra pour cela un soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes. Les échanges se tiendront de façon virtuelle.
La COP 30, organisée par l’ONU du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, dans le nord du Brésil, est une actualité internationale qui porte le développement des échanges académiques. La question des indicateurs est interdisciplinaire et intégratrice, elle amène des éléments de dialogue intéressants pour les communautés académiques qui souhaitent placer leurs travaux à la disposition de la modernisation des sociétés. La perspective de créer des groupes de travail internationaux pour la 3e édition de ce forum constitue un enjeu central pour la cohérence et la montée en puissance de ce forum étudiant des indicateurs de la transition.
Remerciements
Les auteurs adressent leurs sincères et vifs remerciements aux membres de l’équipe pédagogique, spécialistes, professionnels et élus, étudiants ainsi qu’aux rapporteurs de cet article qui ont, par leur relecture attentive et leurs commentaires, participé à l’amélioration de ce retour d’expérience.
Matériel supplémentaire
Les documents complémentaires à cet article peuvent être téléchargés au format PDF depuis le site Internet du journal, à l'adresse https://doi.org/10.53480/jeeses.bedc
Références
Anderson, M. J. (2015). The American census: A social history (2ᵉ éd.). Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvb1htjr
Aykut, S. C. (2014). Gouverner le climat, construire l’Europe : l’histoire de la création d’un marché du carbone (ETS). Critique internationale, 1, 39-55. https://doi.org/10.3917/crii.062.0039
Bardet, F. (2007). Du recensement au sondage de la population : l’exception démocratique française. Politix, 79, 195-213. https://doi.org/10.3917/pox.079.0195
Bardet, F. (2014). La contre-révolution comptable : ces chiffres qui (nous) gouvernent. Les Belles Lettres.
Boullet, D. (2006). Entreprises et environnement en France de 1960 à 1990. Droz.
Branchu, P., Marseille, F., Béchet, B., Bessière, J.-P., Boithias, L., Duvigneau, C., Genesco, P., Keller, C., Lambert, M.-L., Laroche, B., Le Guern, C., Lemot, A., Metois, R., Moulin, J., Neel, C., & Sheriff, R. (2022). MUSE : Intégrer la multifonctionnalité dans les documents d’urbanisme.
Corso, M., Lagarrigue, R., & Medina, S. (2019). Pollution atmosphérique : guide pour la réalisation d’une évaluation quantitative des impacts sur la santé (EQIS). Santé publique France.
Daccache, M. (2011). La rationalisation économique du rapport à la biodiversité : éléments d’ethnographie. Quaderni, 76(3), 53-65. https://doi.org/10.4000/quaderni.126
Dassibat, Q. (2024). Quelles données environnementales pour territorialiser les limites planétaires ? Un cas d’étude sur l’évaluation environnementale absolue de l’intégrité des cours d’eau dans le territoire du ScoT du Sud-Loire [Mémoire de doctorat, Mines Saint-Étienne]. https://doi.org/10.51257/a-v1-ag504
Delahais, T., Ottaviani, F., Berthaud, A., & Clot, H. (2023). Bridging the gap between wellbeing and evaluation : Lessons from IBEST, a French experience. Evaluation and Program Planning, 97, 102237. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102237
Desrosières, A. (2003). Les qualités des quantités. Courrier des statistiques, 105-106, 51-64.
Desrosières, A. (2008). Pour une sociologie historique de la quantification. Presses des Mines. https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.901
European Environment Agency. (2023). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023 : Technical guidance to prepare national emission inventories. Publications Office.
ISO. (2006). ISO 14040:2006 Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre.
Jany-Catrice, F., & Zotti, R. (2009). La santé sociale des territoires : un indicateur de santé sociale pour les régions françaises. Futuribles, 350, 65-88. https://doi.org/10.1051/futur/200935065
Jouzel, J. (2022). Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l’enseignement supérieur. MESR.
Maljean-Dubois, S., Vermeersch, S., & Deboulet, A. (2024). Les sociétés face aux défis climatiques. CNRS Éditions.
McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrellio, C., & Obura, D. (2024). IPBES Nexus Assessment : Summary for policymakers.https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289
Millennium Ecosystem Assessment (dir.). (2005). Ecosystems and human well-being. Vol. 5 : Our human planet : Summary for decision-makers. Island Press.
Ministère de la Transition écologique. (2020). Rapport de première phase de l’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques : du constat à l’action. Direction de l’information légale et administrative.
O’Brien, K., Garibaldi, L. A., Agrawal, A., Bennett, E., Biggs, R., Calderón Contreras, R., Carr, E. R., Frantzeskaki, N., Gosnell, H., Gurung, J., Lambertucci, S. A., Leventon, J., Chuan, L., Reyes García, V., Shannon, L., Villasante, S., Wickson, F., Zinngrebe, Y., Périanin, L., Bridgewater, P., & Zaccagnini, M. E. (2025). IPBES Transformative Change Assessment : Summary for policymakers. https://doi.org/10.5281/zenodo.15095763
Richard, J. (2012). Comptabilité et développement durable. Économica.
Salais, R. (2004). La politique des indicateurs : du taux de chômage au taux d’emploi dans la stratégie européenne pour l’emploi. Dans B. Zimmerman (dir.), Les sciences sociales à l’épreuve de l’action : le savant, le politique et l’Europe, p.287-331. Maison des Sciences de l’Homme.
Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries : Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), 1259855. https://doi.org/10.1126/science.1259855
Valiergue, A. (2020). Compensation carbone : la fabrique d’un marché contesté. Presses de l’Université Paris-Sorbonne.